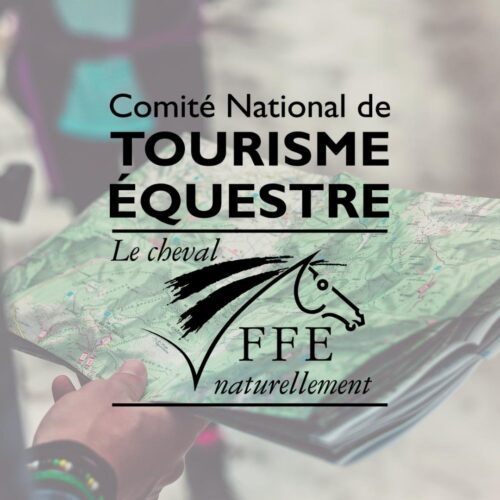La voiture
Le propriétaire doit faire réviser la voiture d’attelage au moins une fois par an, et davantage en cas d’usage intensif ou de départ pour une randonnée au long cours. Commencez par un bon nettoyage qui vous donnera accès à tous les recoins et vous facilitera la vérification du serrage de tous les boulons. Un graissage soigné s’impose.
- Pour les voitures anciennes à essieu Patent, après démontage des roues, le graissage se fait avec de l’huile.
- Pour les voitures à essieu à graisse, il se fait évidemment avec de la graisse assez épaisse. Ne pas oublier de graisser la tourelle du train avant
- Pour les roues à pneus, il convient de gonfler à la pression maximum et de la vérifier 2 ou 3 jours plus tard.
Vérifiez l’état des bandages des roues à bandage caoutchouc. Enfin, sur les roues en bois anciennes, assurez-vous que les rais ne jouent pas entre le moyeu et les jantes. En randonnée, pour le confort des chevaux en paire, attelez avec un timon qui dépasse largement le poitrail des chevaux. Cela facilitera leur travail en descente pour retenir leur voiture et les aidera pour reculer. En compétition, les palonniers sont très courts, là encore pour le confort des chevaux, en randonnée, n’hésitez pas à les choisir d’une dimension plus importante même s’ils dépassent la largeur de la voiture pour éviter que les traits ne frottent sur la croupe. Faire 30 kilomètres par jour n’a rien à voir avec la compétition d’une journée.
Le harnais
Il sera démonté entièrement, nettoyé et vérifié. Les parties endommagées seront réparées ou changées. L’état des guides est capital. Vérifiez que la partie en contact avec la bouche du cheval n’a pas été mâchonnée, ce qui la fragiliserait. Sur un attelage à un, la sous-ventrière de la sellette est mobile sur la sangle pour une voiture à deux roues et fixe pour une voiture à quatre roues. Sur les attelages en paire, les mantelets ont une sangle fixe. Avec un timon plus long pour des raisons de confort et de facilité de manœuvre (recul, retenue en descente), les chaînettes doivent aussi être plus longues.
Le cheval
Il va sans dire qu’il doit être ferré régulièrement. Des maréchaux racontent des histoires insensées. Ils sont appelés la veille d’un départ en randonnée ! La durée d’une ferrure est d’environ cinq semaines même en cas de non usure des fers car la pousse de la corne entraîne une modification des aplombs. En cas d’usure prématurée due à une utilisation intensive, les fers seront évidemment remplacés. On peut améliorer le temps d’usage par des pointes de tungstène.
Un vétérinaire ou un dentiste équin vérifiera les dents une fois par an, faute de quoi le cheval risque de se blesser au contact du mors. En toilettant le cheval, n’oubliez pas de raccourcir la queue qui ne doit pas toucher le sol. En reculant, il risquerait de marcher dessus et de se faire mal. Ne pas épiler les poils en haut de la queue pour le passage du culeron. Ces poils sont bien utiles pour éviter l’entrée de mouches plates et le risque d’une ruade !
Mais l’essentiel, c’est le compagnon avec lequel il va falloir établir la confiance. Tout est dans la ritualisation des demandes.

La sécurité de l’équipage en attelage
Rappelons quelques précautions intangibles.
- Un cheval ne peut être amené à la voiture que entièrement harnaché, bride et guides en place. Aucune pièce du harnais, comme les traits par exemple, ne doit traîner par terre.
- Personne ne monte dans la voiture avant le meneur. De même, les passagers descendent de la voiture avant lui.
- Pour la sécurité, un coéquipier est obligatoire.
L’attelage, pratique dangereuse ?
Ce n’est pas l’attelage qui peut être dangereux, c’est la négligence de rituels impératifs. Le cheval prend l’habitude de ces rituels, il a de la mémoire. Un acquis est pérenne. Avez-vous regardé les westerns américains ? Lorsqu’un cavalier de l’armée américaine ou un cow-boy descend de cheval, il laisse tomber une de ses rênes à terre parce qu’il ne les relie pas. Le cheval s’immobilise et le cavalier peut s’éloigner, son cheval ne bougera pas. Alors, le cheval d’attelage qui ne veut pas marquer l’arrêt, vous ne croyez pas que c’est son meneur qui ne sait pas lui demander ? L’élément essentiel entre le meneur et le cheval est la voix. Le cheval connaît son nom ; lui parler, c’est le rassurer, établir la confiance. Les indications : arrière, hola, etc. accompagnent la demande transmise par les guides. Ces principes sont valables pour un meneur ou un cavalier comme le montre l’épisode historique suivant.
Extrait de l’Epopée du Cadre noir de Saumur de Jacques Perrier. Editeur Lavauzelle
A la moitié du 19ème siècle, le commandant Rousselet, écuyer du Cadre noir, contrairement aux autres écuyers qui ne voyaient l’équitation que par la soumission et la domination du cheval, avait la coquetterie de monter ses chevaux avec pour seule contrainte un ruban de soie dans la bouche.
En mars 1847, Chasseur était la terreur des lieutenants instructeurs qui le considéraient comme un assassin. Emballé, Chasseur venait de ramener à l’écurie son cavalier couché sur l’encolure avant de le jeter dans la mangeoire.
Le commandant Rousselet demanda qu’on lui amène, le fit débrider et lui passa le ruban de soie qu’il avait toujours dans sa poche.
« Je vais le monter devant vous. J’irai au fond du Chardonnet. Je reviendrai au galop de charge et je l’arrêterai là. Et le commandant Rousselet traça une croix sur le sable avec le bout de sa cravache. Puis il s’adressa à Chasseur :
« Voyons Chasseur, je veux te monter et je suis un vieil écuyer, bien vieux, alors tu seras gentil ».
« Messieurs, il n’a pas l’air de comprendre, je vais recommencer ».
Il lui parla longuement d’une voix douce, en lui flattant l’encolure, le grattant entre les oreilles, puis il ajouta :
« Messieurs, Chasseur a compris, je vais le monter. ». Et il fit très exactement ce qu’il avait décidé. Le cheval emballé s’arrêta pile au commandement de M. Rousselet : Hola !
« Quel est votre secret ? » lui demanda un lieutenant. « Très simple, messieurs. Le cheval, c’est comme un violon. Il faut avant tout savoir l’accorder, puis, une fois accordé, savoir jouer juste. »
M. Rousselet ne montait jamais un cheval sans avoir vérifié son harnachement, sans le prévenir, lui parler. Toutes choses paraissant élémentaires aujourd’hui, mais qui n’étaient pas pratiquées à l’époque.* C’est tout, le respect et l’échange avec le cheval.

Estafette 156 – Par André Grassart
Crédit photo intro ©Clara-Chatel